Huitième Secousse - Terre pâle, sèche, brûlée
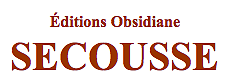
Terre pâle, sèche, brûlée
Quelques mots tout d’abord sur l’ouvrage lui-même, son contenu : huit essais parus sous le titre Mornings in Mexico en 1927, suivis de dix autres jamais réunis en français. Quant à la circonstance, j’avoue qu’elle prend à mes yeux autant d’intérêt que la note elle-même, si ce n’est davantage, dans la mesure où, ne faisant pas de la critique mon activité principale, l’acte de revenir sur une lecture, au risque d’en atténuer le charme premier, dit quelque chose de la relation toute particulière tissée entre un texte et son lecteur. Circonstance assez inhabituelle, puisque, abandonné à mon seul plaisir, je lisais ces soirs-ci, contrairement à mon habitude, sans crayon à la main. Mais de ce plaisir il me faut dire quelques mots aussi, ne fût-ce que pour saluer le remarquable travail de l’éditeur, grâce à qui je tenais entre les mains un de ces livres dont on rêve, fatigué qu’on est parfois par tant de publications qui n’éveillent pas la moindre émotion et ne comblent en rien notre attente. Sans crayon à la main, disais-je, autant dire sans compte- rendu à rédiger, ce à quoi je m’attelle aujourd’hui, essayant de retrouver la fraîcheur initiale, ressentie dès les premières pages, au point d’éprouver sans tarder, comme touché par une mystérieuse révélation, le besoin réel de faire tôt ou tard – ou de tenter de faire – partager le plaisir que j’éprouvais à l’instant même. Il en va ainsi de certains livres. Mais j’ai évoqué le plaisir et ne doute pas du point de vue subjectif dont il provient. Encore que la qualité d’écriture, le ton ferme et dégagé de l’écrivain – si bien rendu ici, je veux dire dans notre langue –, ne puisse guère être contestée. Reste que l’écriture ne fait pas tout, à tout le moins dépend-elle de maints facteurs.
À commencer par une qualité de regard, cette façon de s’emparer du détail le plus infime, ce que Lawrence, qui a l’art du récit, ne dissocie pas de sa volonté de se situer dans le présent, d’y tenir – sans grandiloquence, ainsi qu’il le mentionne – chronique de l’instant, par une narration qui ne dissimulant pas son plaisir recourt à tous moyens capables de saisir le vivant – onomatopées notamment, expressions du parler local… S’en suit un rythme auquel l’écrivain semble particulièrement attentionné – et son traducteur du même coup, à qui l’on doit la traduction de Croquis étrusques chez le même éditeur. On n’a rien dit de l’enchantement qui nous saisit au fil des pages, dont on pressent qu’il provient de plusieurs sources : bribes de la fable du monde dont Lawrence émaille son récit, l’agrémentant de réflexions – tantôt savantes, tantôt ironiques voire ludiques –, pépites que seul un regard doublé d’un esprit aiguisé sait lever. Un regard qui ne néglige rien de ce qui l’entoure et qui constitue son cadre de vie. La maison tout d’abord, débordant de parfums et d’odeurs montés de ces matins dont on ne tarde pas à comprendre qu’ils inaugurent autre chose que la seule journée, et tout ce à quoi la maison doit sa vie propre. Ainsi des perroquets, de Corasmin, « petit chien blanc gras et frisé », sans oublier Rosalino, jeune indigène qui « fait partie de la maison bien qu’il ne soit en service ici que depuis deux mois ». Cette attention au monde, alors réduit à un lieu et aux quelques êtres qui l’habitent, n’est pas sans effet sur le lecteur bientôt convié à partager le temps d’un écrivain qui, entre autres voyages et déambulations, vécut dans le Sud-Ouest américain et au Mexique l’essentiel des années 1922-1925. Un espace du monde mal connu alors. Et qui ne l’est sans doute guère davantage, pour beaucoup s’entend, et en profondeur ; ce dont on prend conscience peu à peu.
Les premiers essais passés, attachés plus spécialement à la vie quotidienne de Lawrence parmi les Indiens, le texte s’ouvre à la dimension sacrée de civilisations dont on mesure soudain la richesse. Les titres des essais qui suivent, et qui constituent le cœur de l’ouvrage, pour ne pas dire son âme (La danse du maïs en herbe, La danse du serpent chez les Hopis), parlent d’eux-mêmes. Autant de pages remarquables, tant par la description méticuleuse des faits et gestes des officiants que par la dimension sacrée qui se dégage du mouvement général. Se défiant de toute interprétation extérieure, Lawrence ne brode pas, note ce qu’il voit. En cela, ces pages constituent un véritable document ethnographique – écriture en regard, comme de carnets, mais retravaillée du côté du poème, dans la langue, pour dire un lieu : « terre pâle, sèche, brûlée, qui s’effrite en une poussière de sable fin », inséparable de l’esprit qui l’habite. L’écriture, dont certains rythmes répondent à la transe exacte de l’instant, sert au mieux l’un et l’autre.
Pascal Commère
