Tartalacrem.blog.lemonde.fr - Die Schönen Tage von Aranjuez (Les Beaux Jours d'Aranjuez), mise en scène par Luc Bondy. Ou comment faire de l'anti-Py
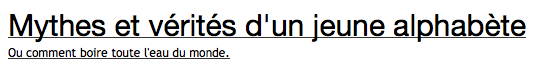
Die Schönen Tage von Aranjuez (Les Beaux Jours d'Aranjuez), mise en scène par Luc Bondy. Ou comment faire de l'anti-Py
C’est un peu un pavé lancé par-dessus l’épaule et qui aurait atterri dans une mare avec forces éclaboussures, que cette dernière création de Luc Bondy mais première en tant que directeur du Théâtre de l’Odéon. Celui dans lequel on veut voir la consécration du syncrétisme théâtral européen a donné, mercredi soir, un spectacle aux antipodes des créations de l’ancien directeur, Olivier Py, débouté inélégamment par Frédéric Mitterrand il y a un an et demi. Même s’il a repris la tradition germanophile qu’avait commencé à établir l’idole de Laure Adler et de Claire Chazal (en même temps qui, aujourd’hui, lorsqu’il observe les évolutions de la scène allemande peut se défaire de cet irrésistible tropisme teuton ?) en proposant une version traduite de Les Beaux Jours d’Aranjuez de Peter Handke qui avait rédigé ce texte en français, le metteur en scène de 64 ans assoit une esthétique qui jure avec ce qui se faisait dernièrement dans la maison : le rire, la beauté, le souffle, tout est savamment retenu, dans une sorte de reprise de respiration perpétuelle pour une plus grande fragilité de l’action et du mot.
Le texte, qui explore les sorts et les ressorts de l’amour dans ses dimensions les plus politiques, les plus sociales et finalement les plus intimes, nous plonge dans une atmosphère dont l’auteur autrichien avait peu habitué son public : moins drôle, sans doute plus profond, la phrase y est moins décortiquée et retournée en tous sens. Peut-être plus compréhensible. Ce dialogue introspectif interroge la vie d’une femme, dont on apprendra finalement qu’elle s’appelle Soledad, de son rapport à l’amour, aux amours. Dans des descriptions lancinantes de beauté, elle rappelle à sa mémoire violentée et violente les paysages moraux qui firent d’elle ce qu’elle est. Voire ce pourquoi elle se trouve aujourd’hui en face de cet homme, Fernando. Qui l’aime ? Qui la désire, à n’en point douter. Pas de pomme entre eux pour expliquer ni amour ni discorde. Juste une table et deux chaises tout ce qu’il y a de plus laid et de moins présentable sur une scène de théâtre. Derrière eux, un grand rideau clos, un arrière de scène avec costumes suspendus et paravent peint maladroitement. Assez moche en somme. Mais assez cruel pour que l’on puisse s’imaginer rompre une intimité que l’on cherche à nous cacher.
La force de la pièce tient aussi (sans doute surtout) dans ses interprètes : elle et lui. Dörte Lyssewski et Jenz Harzer. Lui, parlant cet allemand sec, un peu haché. Elle, magnifique de sensibilité, d’une douceur absolue. D’une douceur, mais surtout d’un érotisme et d’une sensualité inégalable. Dans une robe qui colle à son corps de façon quasi obscène, moulant sa poitrine dans une sorte de strabisme divergeant, elle a cette capacité suprême qu’ont quelques comédiennes et actrices à faire naitre un désir au plus profond de chacun, provocant par une lascivité exacerbée mais sans beauté évidente, comme un frisson à chacun de leurs mouvements.
Plusieurs fois, au cours de la pièce, elle esquisse comme un départ pour passer le rideau situé en fond de scène. Comme une mise en exergue absolue du sentiment qui sourd tout spectateur pendant toute la pièce : un pressenti de magnificence et de beau, presque facile, mais aussitôt arrêté net par la mise habile de Luc Bondy. De même, les bruits, à peine entendus, de nature, les musiques, murmurées sans que l’on puisse pleinement les considérer, les pas de danse, les mimes, et puis surtout elle, dans un halo de lumière qui se prépare pour un spectacle que l’on ne verra jamais… Tout est donné et immédiatement repris.
Pas ici de grandiloquence à la gloire du théâtre et de ses protagonistes, pas de déclamation à la beauté tapageuse, pas de volonté de mise en avant du mot et du geste dans un ultime besoin de s’inscrire puissamment dans l’espace politique. Mais l’on retrouve le théâtre dans le théâtre, le halo de lumière qui fait la starlette, le costume que l’on enfile. Sauf que cette fois-là, rien est évident.
Espérons maintenant que le directeur de l’Odéon s’en sorte au moins aussi bien, même si dans notre générosité, on lui accorde bien volonté un peu plus de facilité pour le plus grand bonheur de notre compréhension, dans ses autres productions. Mais attention, Pinter n’est pas Handke, Lyssewski pas Seigner, Harzer pas Garrel… les questions de remplissage de salle avec des célébrités du monde des branchés n’ont pas à être des siennes.
